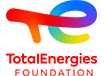À Houston, l’énergie collective au service de l’intérêt général
Voir la vidéo
Le programme TotalEnergies Foundation recouvre les actions d’intérêt général menées chaque jour dans le monde par TotalEnergies et ses filiales. La Compagnie souhaite ainsi participer au dynamisme de ses territoires d’ancrage en accompagnant plus particulièrement les jeunes. Avec ses partenaires, elle agit en priorité dans quatre domaines : l’éducation et l’insertion ; la sécurité routière ; le climat, les littoraux et les océans ; le dialogue des cultures et le patrimoine. Elle implique aussi ses collaborateurs qui peuvent consacrer jusqu’à 3 jours par an de leur temps de travail à des missions d’intérêt général. TotalEnergies Foundation contribue ainsi à l’engagement citoyen de la Compagnie.